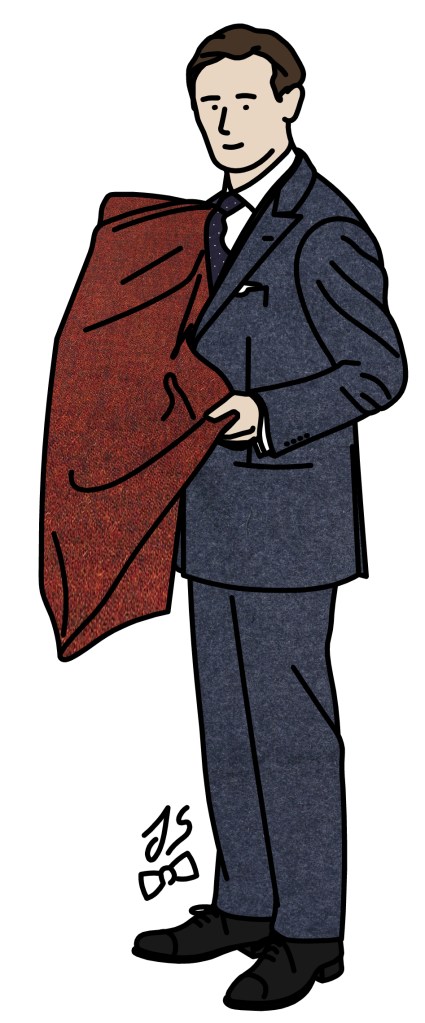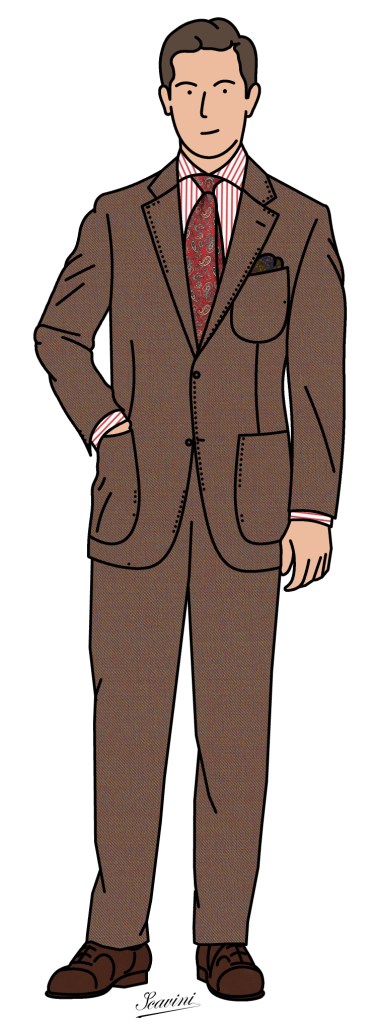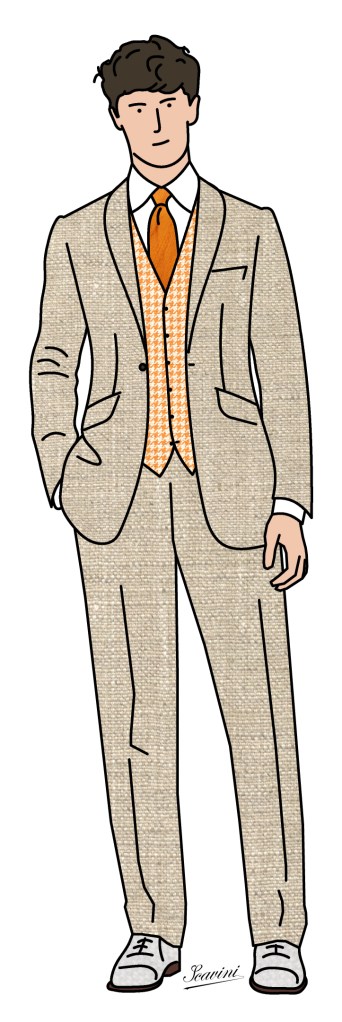J’admire sincèrement les magazines spécialisés comme GQ, Monsieur, Dandy et d’autres moins spécialisés au détour d’articles sur le sujet, capables de s’extasier sur ce qu’ils appellent « le grand retour du costume ». Ils célèbrent une prétendue effervescence, une renaissance sartoriale, un nouvel âge d’or du tailoring. Une telle méthode Coué force presque le respect. Car non, je ne crois pas, moi, que le costume soit sauvé. Ni même qu’il soit plus présent qu’hier.
Évidemment, c’est une constatation un peu amère pour un tailleur – et je le dis avec un pincement au cœur. J’aimerais croire à cette résurrection. Mais je ne vois pas la foule des vestons revenir dans la rue. Et c’est d’autant plus cruel que, chaque semaine au Figaro, ma tâche consiste précisément à écrire sur les usages et les coutumes du costume : comment choisir sa cravate, pourquoi préférer les pinces à un pantalon plat, quelle est la raison d’être des revers en bas du pantalon, ou encore l’art discret de la pochette.
Alors, parfois, au milieu d’une chronique sur le bon pli du pantalon, une question me traverse : à quoi bon ? Qui s’intéresse encore à cela ? Lorsque l’on « traîne » — pardonnez-moi l’expression — dans notre milieu sartorial, ce ne sont pas des lunettes que l’on porte, mais des prismes. Des prismes qui déforment tout. À force de regarder Hugo Jacomet ou Simon Crompton, de surveiller l’Instagram de Cifonelli ou Rubinacci, d’écouter des podcasts ou des youtubeurs plus ou moins en vue, on finit par vivre dans un monde parallèle. Surtout que plus ils sont jeunes, plus ils sont péremptoires. L’étais-je aussi? Diantre.
Un monde où l’on croit encore que l’élégance règne, que le costume a droit de cité, que les hommes s’habillent pour le plaisir. C’est peut-être cela, au fond, l’idée : s’inventer un univers plus élégant, plus chic, moins basique, moins vulgaire. Se mettre en marge pour, comme disait Saint Laurent, vivre en beauté.
Mais il suffit de lever les yeux pour que le rêve s’effondre. Dans la rue, le costume a déserté. On n’en croise plus guère que dans les mariages ou sur quelques banquiers en sursis. Aux enterrements ? même pas, j’en parle assez ici. Le reste du temps, la norme est ailleurs : baskets, sweat-shirts, pantalons mous. Le confort a gagné la bataille, et l’élégance, elle, s’est réfugiée dans les marges — sur Instagram, dans les ateliers, dans les souvenirs.
Je ne dis pas que c’est mal. Le monde change, les usages aussi. Simplement, il faut avoir l’honnêteté de le reconnaître : le costume n’est plus un habit social, il est devenu un manifeste. Le porter aujourd’hui, c’est déjà faire un pas de côté, affirmer quelque chose. Non pas un pouvoir ou une réussite, mais une idée — celle que s’habiller peut encore être un acte de culture, presque de résistance.
Mon reproche envers les annonciateurs du « grand retour » du costume est là. Ils n’arrivent pas à s’extraire de leur propre environnement mental — un monde où le costume n’est pas seulement une passion, mais surtout un fond de commerce. Leur enthousiasme est sincère, sans doute, mais il repose sur une illusion. Le préambule nécessaire, incontournable même, à toute réflexion sur le sujet devrait être celui-ci : reconnaître la réalité. Et j’aime le faire, avec force.
Non, nous ne sommes plus dans les années 1990, lorsque le commercial de chez Xerox, le chargé de compte du Crédit Lyonnais ou l’inspecteur de la PJ portaient encore un costume. Si, si, au commissariat, ils portaient des costards. Ces trois hommes, aujourd’hui, sont en jean. Peut-être en chino. La légion des hommes en costumes s’est muée en une poignée d’irréductibles, accrochés à une certaine idée de l’ultra-urbanité : grands avocats, cadres de très grands groupes, messieurs âgés.
Une fois ce préambule posé sur l’état réel du costume, il est possible d’observer non pas un sursaut, ni même un retour, mais une permanence. Une ligne de fond, ténue mais stable.
Cette permanence se compose, à vrai dire, de trois types d’hommes. D’abord, ceux que je viens d’évoquer : 1- les représentants d’une certaine élite urbaine, pour qui le costume demeure un signe de position plus qu’un plaisir. 2- Ensuite, les mariés, qui assurent, pour bien des tailleurs, une part essentielle du chiffre d’affaires — j’oserais même dire, leur survie. 3- Enfin, les jeunes néophytes, souvent passionnés, curieux, parfois maladroits, mais animés par un véritable désir de style.
Il faut être clair sur ce deuxième point. Moi-même, comme tant d’autres — parfois à des niveaux bien supérieurs au mien, surtout en province —, nous nous appuyons sur l’abondance des mariés en quête d’un « costard » pour faire tourner nos ateliers. C’est une réalité simple, parfois un peu crue, mais indéniable. Derrière nous, les usines et les ateliers semi-industriels tiennent encore debout grâce à cette demande. Et j’aimerais insister sur ce fait : sans les mariés, l’écosystème industrialo-tailleur s’effondrerait. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle tout cet univers met autant en avant la notion de « cérémonie ». Sans elle, sans ce rite de passage, sans cette journée où l’on consent encore à se vêtir avec soin — malgré ses excès, ses dérives de mauvais goût, ses nœuds papillon en bois et ses thèmes de couleurs —, l’amateur de costume serait bien seul avec ses envies. Car il n’aurait plus beaucoup de choix.
Enfin, arrivons à la troisième catégorie : les jeunes néophytes. Eux n’ont pas connu leurs parents en costume. Nés autour de l’an 2000 — ou plus tard encore —, ils découvrent l’habit ici et là, souvent par curiosité, parfois par fascination. Comme moi il y a quinze ans? Ce qu’ils perçoivent d’abord, ce n’est pas le statut, mais la tenue : la classe de l’objet, sa dignité, ce qui fait propre. Et c’est là leur force. Ces jeunes discernent plus finement qu’on ne le croit, en tout cas bien plus que des quadras. Ils savent faire la différence entre le jean du quotidien, le pantalon un peu habillé et le véritable costume. Les frontières esthétiques, pour eux, sont étonnamment claires.
Ils ne portent pas le costume par devoir, ni par tradition, mais par goût, presque par jeu. En cela, ils sont peut-être les seuls à le considérer encore comme un vêtement de liberté.
Mais est-ce vraiment nouveau, tout cela ? Les magazines peuvent bien s’en émerveiller — et ils ont raison, jusqu’à un certain point —, mais non, ce n’est pas nouveau. À chaque génération, de manière continue, les jeunes redécouvrent le costume, le réinterprètent, se l’approprient à leur manière. Farid Chenoune l’avait déjà montré dans Des Modes et des Hommes. Les jeunes Beatles étaient-ils contraints de porter des costumes, certes revisités par Cardin ? Jacques Dutronc devait-il s’habiller en Renoma ? Non. Ils le désiraient. Et c’est bien cela qui importe.
À chaque époque, on ne constate pas le retour du costume, mais la permanence de l’envie. Une envie qui sommeille, qui ressurgit, qui change de forme, mais ne disparaît jamais tout à fait, c’est en effet ma thèse. Le costume pour ces jeunes, c’est une pièce parmi d’autre dans la garde-robe. C’est une pièce à avoir. Et comme les costumes dans le prêt-à-porter sont de moins en moins présents, la demande s’étiolant – bien que ce soit un peu comme l’œuf et la poule, quel phénomène intervient en premier ? – les tailleurs sont bien placés pour répondre en flux tendu à la petite, mais présente demande !
Le retour du costume, non. La permanence du costume, peut-être. C’est déjà pas mal.
Belle semaine, Julien Scavini