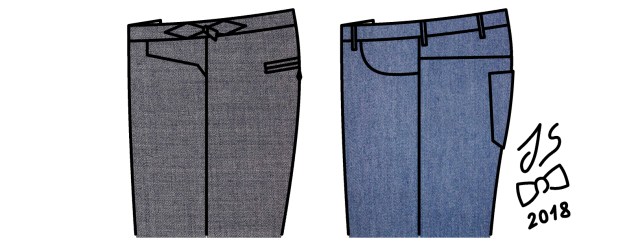Il y a quelques temps, un lecteur du blog m’a prêté un livre au détour d’un passage à la boutique en me proposant de le lire. Pour le plaisir m’a-t-il dit sans plus de détail… Le livre s’intitule Du Temps de Papa. Il a été écrit par un certain Gontran de Poncins (1900-1962) et publié en 1955 par les éditions Julliard. La couverture très cocotte ne m’a pas immédiatement poussé à la lecture. Et puis un jour, j’y ai plongé, sans plus. Passé une citation de Beudelaire « En vérité, je n’avais pas tout à fait tord de dire que le dandysme est une espèce de religion« , les 206 pages s’ouvrent sur la description du dit papa, en fait le comte Bernard de Montaigne, faisant exprès d’arriver systématiquement en retard à la messe donnée dans la chapelle du château. Pas mal de dialogues et d’expressions toutes faites m’ont donné une première impression mitigée, d’une écriture un peu facile et tape à l’œil.

Et puis, le sujet s’est approfondi. Chapitre II, Papa Construit son personnage. A partir de cet instant, le sujet apparait plus clairement et la lecture accélère. On découvre un personnage érudit et élégant, vivant sur un grand pied, un aristocrate tout en panache : « C’est à Paris que Papa s’est trouvé. C’est là qu’il a réalisé sa forme, cet Art de vivre qui était en lui. Car Papa voit naturellement beau, et il veut la perfection. Rien n’est trop beau pour lui, ni trop grand. Il aime les grandes demeures et les grands développement à la française. Ce qui lui aurait fallu, c’est quelque chose de la taille de Versailles ; avec des meubles signés de Jacob ou de Riesener ; des halls ornés de Carle Vernet, des salons pleins de Ruisdael et de Gainsborough ; et des bibliothèques avec, exposés sur des tables, des livres tous en maroquin plein et des armes au fer chaud, reliés par Pasdeloup. Ce qu’il lui faut, c’est le summum de la qualité en tout« .
Au fil des chapitres, le fils décrit à travers son père un monde qui a cessé d’exister déjà au temps de la publication et qui n’est que plus lointain et exotique aujourd’hui, quasiment un siècle après. Le Papa est plein d’esprit et d’un grand humour, que l’auteur distille tout au long de l’ouvrage, évitant de rendre trop sérieux ce qui était très sérieux. La description du voyage en train entre le château et la résidence d’été est particulièrement hilarante. A l’époque, il était concevable de prendre 150 kilos de bagages et d’affréter un wagon pour ses chevaux, avec un bon lit de paille. Aussi hilarante est l’histoire de l’écuyer, William, un bel écossais roux, à l’origine d’une épidémie de rouquins dans le petit village quelques années après… Il y a parfois un peu d’Audiard, comme par exemple à propos d’un grand diner : « Le comte Ali-Bab, lui s’y adonne avec une ferveur qui met Papa en joie. Avec lui, ce n’est plus manger ou boire, c’est aborder chaque mets avec la révérence du connaisseur, le recueillement de l’initié, la mystique de l’apôtre. » Toujours à propos des diners, Gontran de Poncins rapporte avec beaucoup de finesse : « cet Art est autant l’art de Bien Manger que celui d’entretenir ses amis et celui de la politesse. Converser, en sorte que tous les invités sans exception se sentent à l’aise et au mieux de leurs possibilités est de la part du maître de maison un Art infiniment subtil. Il s’agit dès l’arrivée des gens, de les mettre à l’aise, de les faire se sentir bien. Si tel d’entre eux est morose, ou préoccupé, il s’agit de le distraire de son état. Si tel autre est en forme, il faut exploiter cette forme et le faire « mousser » au mieux de l’intérêt général. »
Si la plupart des scènes se déroulent à la campagne et permettent d’en apprendre très long sur les usages et les habitudes au château (un peu à la Dowton Abbey), quelque paragraphes évoquent la vie parisienne : « C’est à Paris que Papa était à son meilleur. Il n’aurait jamais dû en sortir, tant Paris – et Paris seul – était son « climat ». Il avait été à Londres, une fois, passer la soirée au Jockey Club, il s’y était prodigieusement ennuyé. « Les hommes étaient bien mis ; mais ils étaient là, à se pocharder dans des fauteuils, chacun pour soi, sans dire un mot! » Mon père avait regagné précipitamment Paris. Mais sa fortune, et aussi le principe selon lequel il ne pouvait faire les choses à demi, ne lui permettait pas d’y séjourner plus de trois mois par an. A peine arrivé, il commençait par se « remettre en état ». « Je n’ai plus rien à me mettre, je suis honteux! » Il avait beau avoir à la campagne soixante vêtement alignés sur leurs portemanteaux, apparemment cela ne suffisait pas. Et le premier soin de mon père, après avoir surveillé l’installation de ses chevaux – dans une écurie proche de notre appartement – était d’aller chez son chemisier, toujours le même, et chez son tailleur. Le tailleur, comme il sied à une Maison anglaise, n’avait pas de façade. L’appartement, sis au quatrième étage de la rue Royale, était immense et totalement vide. Au bout d’un instant, une porte s’ouvrait. Apparaissait » Mister Plaistoe » : un gentleman très digne vêtu, cela va de soi, très sobrement. […] Monsieur Plaistoe l’emmenait alors, avec la dignité et le savoir-faire britannique, jusqu’à une immense table en bois sombre sur laquelle attendait quelques liasses d’échantillons. Sans laisser à mon père la peine de chercher, il promenait rapidement ses doigts à travers une liasse, avec la vision parfaitement nette de ce que Papa voudrait. »

La description du fils est ambivalente. A la fois pleine d’amour pour ce héros de l’ancien monde, demi-dieu mythologique, et d’une vérité dure pour un père difficile, peut-être absent pour son fils et sa femme – c’est par elle qu’est venu l’argent. Un chapitre est même intitulé Papa est affreusement déçu par son fils.
Autour de la seconde guerre, tout change et évolue très vite « l’œillet est toujours là, à la boutonnières, mais sur le revers usé il fait caricature« . Le téléphone arrive, la Citroën remplace l’élégant attelage, l’usine tue l’artisanat : « chaque fois que Papa fait à Paris une visite rapide, il a une surprise désagréable. Chez Leroy où il a voulu faire réparer sa pendule de voyage, on lui a dit que des mouvements comme cela on n’en fait plus. Idem chez le maroquinier, où on lui annonce que de faire un nécessaire de voyage comme le sien coûterait une fortune. Beck le sellier est mort, personne ne l’a remplacé. […] Ainsi, lentement, sournoisement, cette « forme » merveilleuse qui constitue toute la vie de mon père s’est désagrégée. A la maison, le personnel a passé de trois hommes à deux, puis à un. Octave est parti le premier : avec lui, c’est toute une dignité qui s’en est allée. Puis le chef à son tour s’est retiré, ça a été un coup plus dur encore. Une cuisinière l’a remplacé, quelle déchéance! Un chef, c’était le « glamour » ; une cuisinière, c’est la bourgeoisie ; c’est bon pour ceux qui ont, non des femmes de chambre, mais des « bonnes ». » L’écriture se fait moins tapageuse, le rythme ralentit. L’auteur pousse doucement le roman à sa fin que l’on cherche plus de plus en plus à éviter. « Lui jadis si intraitable sur le glaçage de ses cols, en a un tout mou, comme d’une chemise de nuit. Sa cravate aussi est défraichie« .
Peu à peu, tout s’éteint. Le dernier chapitre dénoue la vie de ses parents – et en même temps que tout un monde – par un truchement tout à fait osé : un parallèle plein de tendresse entre la vie de sa Maman et la bicyclette de jeunesse de sa Maman, dont elle n’avait pas le droit de faire usage et qui a continuellement rouillé et encombré la remise, « ce n’est pas de votre rang disait Papa ». La maman, une grande aristocrate elle aussi, est tout l’inverse du père, près de l’utile et des sous, de la noblesse terrienne qui fait attention pour survivre. Les derniers paragraphes sont presque chuchotés et emplis d’une émotion rare. A peine le rideau baissé, on voudrait recommencer pour ne pas en perdre une miette et de nouveau suivre cet être incroyable et unique.
J’ai mis autant de citations que possible pour que vous puissiez vous aussi ressentir le livre, qui évidement ne se déniche qu’en occasion. Gallica ne l’a pas scanné. L’auteur même semble être tombé dans l’oubli. Même pas un wikipédia en français. J’aimerais rééditer ce livre. Une tâche ardue. Sinon, il faudrait du temps pour le scanner!
Belle semaine, Julien Scavini